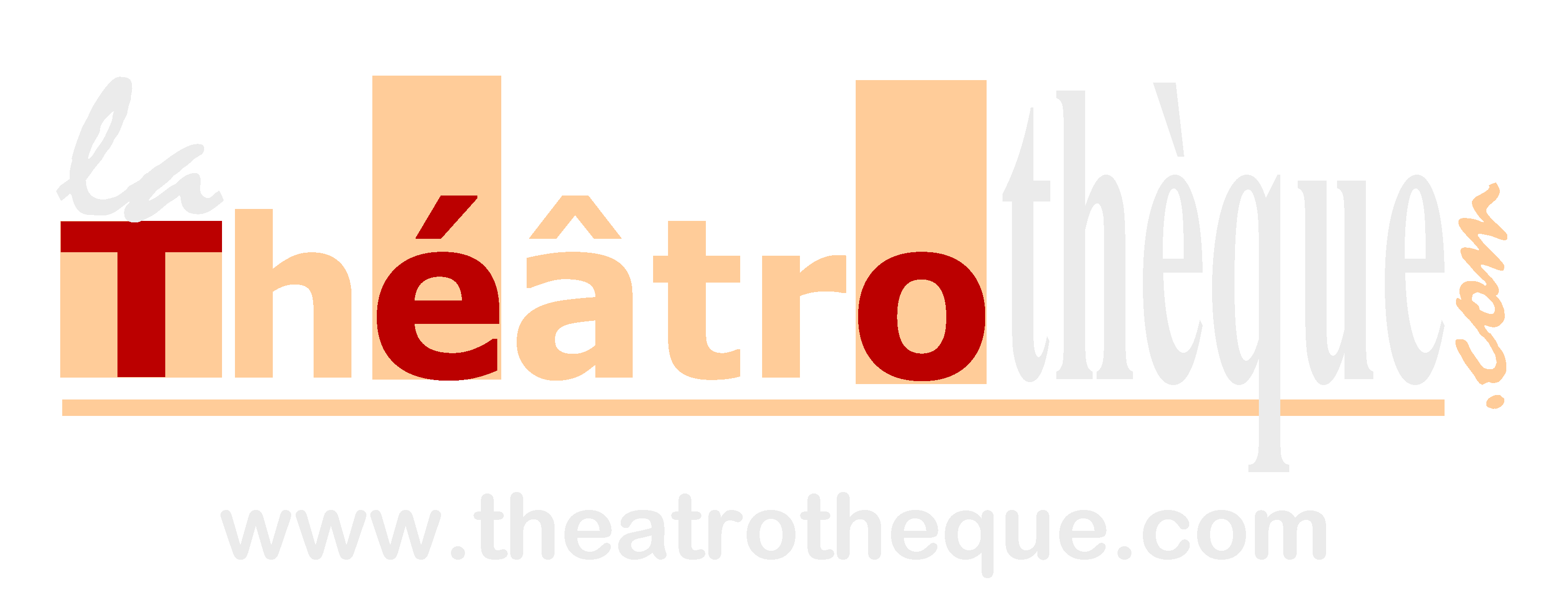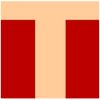Letter to a man
Letter to a man
de Robert Wilson, Christian Dumais-Lvowski
Mise en scène de Robert Wilson
Avec Mikhail Baryshnikov.
-
-
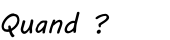
Du 15/12/2016 au 21/01/2017
20h30. Dimanche à 15h.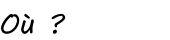
Espace Pierre-Cardin
1,3 avenue Gabriel
75008 PARIS
Métro Concorde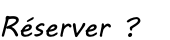
08 92 68 36 22 (0,34€/mn)
Site Internet
Spectacle unique, on ne peut qu’être médusé par la prestation de l’étoile-Baryshnikov qui descend spécialement de son empyrée pour incarner une légende.
Waslaw Fomitch Nijinski, le plus grand de tous les danseurs, interprété par l’étoile la plus célèbre de la planète, tel est le pari de Bob Wilson, toujours aussi inventif qu’il y a quarante-cinq ans, quand il monta Le Regard du Sourd. Ce qu’il nous propose, c’est un "voyage" au sens où l’entendent les accros du LSD, c’est-à-dire une heure quinze dans les méandres d’un cerveau sur le point de craquer et qui craque devant nous.
Un homme, assis sur une chaise au dossier carré, fait irruption sur scène dans une lumière glaçante. Il est maquillé comme un clown, visage blanc, lèvres assassines. Il porte un frac, mais on ne s’en rend pas compte tout de suite. Les mains collées aux hanches, on a l’impression qu’il est enfermé dans une camisole de force. La vision est fugitive, il disparaît sous le coup d’une carabine de fête foraine. Puis, deuxième vision, avec un éclairage différent, une autre pose. Barayshinkov – qu’on est loin de reconnaître alors qu’on a encore en mémoire les élévations surhumaines du prince dans Giselle – grimace dans son impuissance de dément. Mais tout bouge autour de lui, et des décors, et du son, et à nouveau de l’éclairage.A la lumière froide d’une rampe au néon succèdent les loupiotes 1900, mandarine, rassurantes et se mettant à clignoter au rythme d’une opérette ou d’une marche digne d’une pièce de Brecht. L’intermittence entre ces deux clartés a quelque chose de douloureux. Le cortex file et se déchire comme un bas de soie. Les images se succèdent, tantôt cruelles, sur fond de voix mécaniques – presque la tonalité d’Antonin Artaud – et venues de l’ultra-mental, tantôt apaisantes dans un bleu idyllique avec un oiseau blanc qui se profile dans le ciel. A nouveau dans le Siècle, la silhouette fluide de celui qui fut le phare du New York City Ballet entame un pas de danse. C’est cette fois Fred Astaire qui glisse et tourne en roi d’Hollywood, mais l’homme se déglingue, les gestes deviennent des gestes d’automate, de marionnette dérisoire. On est maintenant dans Cabaret, avec la vulgarité berlinoise d’un mangeur de saucisse. Mais très vite l’appel est là et tonne ou roule : la voix de Baryshnikov en russe ou en anglais parsemée de quelques bribes de français. La traduction s’inscrit sur trois écrans, un à droite, un autre à gauche et le troisième au-dessus du manteau d’Arlequin.Mais soudain, la silhouette flexible s’est drapée dans un grand manteau noir qui rase le sol. On la voit surtout de dos, comme ces créatures qui émaillent en contre-jour les tableaux du peintre Magritte. Et il se met à tendre vers l’Au-delà : "Dieu n’est pas une créature en les choses, mais n’est qu’une chose". Ces divagations aboutiront à une cartitude – la certitude du fou : "Je suis homme, Dieu est en moi, je suis en Lui"... Cette fois, il est passé de l’autre côté du miroir ; il y restera plus de trente ans.
Assez curieusement, sa schizophrénie est un pont vers les hommes, dans un altruisme absolu. Nous éclaire-t-elle sur le sens du titre donné au spectacle. En fait, Letter to a Man peut s’entendre de deux manières. C’est d’abord une lettre à l’amant, Serge Diaghilev, qui a fécondé son talent, puis qui l’a rejeté, déclenchant ce chaos et, pour nous, ce gouffre aux brisures syntaxiques qui est le texte de ce journal. Mais Letter est surtout une lettre à l’humanité, lettre qu’aurait écrite Dieu. Ce Dieu qu’il est devenu et qui, par amour, se penche vers la race humaine.
Spectacle unique, on ne peut qu’être médusé par la prestation de l’étoile-Baryshnikov qui descend spécialement de son empyrée pour incarner une légende. Or, c’est lui aujourd’hui la légende. Quant à Robert Wilson, il n’accuse pas une ride. L’ensemble de l’équipe le magnifie : texte de Christian Dumais-Lvowski, dramaturgie de Darryl Pinckney, musique de Hal Willner, paraphrasant musiques et standards, costumes de Jacques Reynaud, lumière de A.J. Weissbard, et il faudrait citer tous les membres de cette production, à laquelle s’associent les noms de plusieurs festivals, théâtres, universités. Ici, à Paris, on la doit au Théâtre de la Ville. L’Espace Pierre-Cardin l’accueillent, là où en 1971 eut lieu ce spectacle-happening, Prologue au Regard du Sourd. En somme, la boucle est bouclée.
Un homme, assis sur une chaise au dossier carré, fait irruption sur scène dans une lumière glaçante. Il est maquillé comme un clown, visage blanc, lèvres assassines. Il porte un frac, mais on ne s’en rend pas compte tout de suite. Les mains collées aux hanches, on a l’impression qu’il est enfermé dans une camisole de force. La vision est fugitive, il disparaît sous le coup d’une carabine de fête foraine. Puis, deuxième vision, avec un éclairage différent, une autre pose. Barayshinkov – qu’on est loin de reconnaître alors qu’on a encore en mémoire les élévations surhumaines du prince dans Giselle – grimace dans son impuissance de dément. Mais tout bouge autour de lui, et des décors, et du son, et à nouveau de l’éclairage.A la lumière froide d’une rampe au néon succèdent les loupiotes 1900, mandarine, rassurantes et se mettant à clignoter au rythme d’une opérette ou d’une marche digne d’une pièce de Brecht. L’intermittence entre ces deux clartés a quelque chose de douloureux. Le cortex file et se déchire comme un bas de soie. Les images se succèdent, tantôt cruelles, sur fond de voix mécaniques – presque la tonalité d’Antonin Artaud – et venues de l’ultra-mental, tantôt apaisantes dans un bleu idyllique avec un oiseau blanc qui se profile dans le ciel. A nouveau dans le Siècle, la silhouette fluide de celui qui fut le phare du New York City Ballet entame un pas de danse. C’est cette fois Fred Astaire qui glisse et tourne en roi d’Hollywood, mais l’homme se déglingue, les gestes deviennent des gestes d’automate, de marionnette dérisoire. On est maintenant dans Cabaret, avec la vulgarité berlinoise d’un mangeur de saucisse. Mais très vite l’appel est là et tonne ou roule : la voix de Baryshnikov en russe ou en anglais parsemée de quelques bribes de français. La traduction s’inscrit sur trois écrans, un à droite, un autre à gauche et le troisième au-dessus du manteau d’Arlequin.Mais soudain, la silhouette flexible s’est drapée dans un grand manteau noir qui rase le sol. On la voit surtout de dos, comme ces créatures qui émaillent en contre-jour les tableaux du peintre Magritte. Et il se met à tendre vers l’Au-delà : "Dieu n’est pas une créature en les choses, mais n’est qu’une chose". Ces divagations aboutiront à une cartitude – la certitude du fou : "Je suis homme, Dieu est en moi, je suis en Lui"... Cette fois, il est passé de l’autre côté du miroir ; il y restera plus de trente ans.
Assez curieusement, sa schizophrénie est un pont vers les hommes, dans un altruisme absolu. Nous éclaire-t-elle sur le sens du titre donné au spectacle. En fait, Letter to a Man peut s’entendre de deux manières. C’est d’abord une lettre à l’amant, Serge Diaghilev, qui a fécondé son talent, puis qui l’a rejeté, déclenchant ce chaos et, pour nous, ce gouffre aux brisures syntaxiques qui est le texte de ce journal. Mais Letter est surtout une lettre à l’humanité, lettre qu’aurait écrite Dieu. Ce Dieu qu’il est devenu et qui, par amour, se penche vers la race humaine.
Spectacle unique, on ne peut qu’être médusé par la prestation de l’étoile-Baryshnikov qui descend spécialement de son empyrée pour incarner une légende. Or, c’est lui aujourd’hui la légende. Quant à Robert Wilson, il n’accuse pas une ride. L’ensemble de l’équipe le magnifie : texte de Christian Dumais-Lvowski, dramaturgie de Darryl Pinckney, musique de Hal Willner, paraphrasant musiques et standards, costumes de Jacques Reynaud, lumière de A.J. Weissbard, et il faudrait citer tous les membres de cette production, à laquelle s’associent les noms de plusieurs festivals, théâtres, universités. Ici, à Paris, on la doit au Théâtre de la Ville. L’Espace Pierre-Cardin l’accueillent, là où en 1971 eut lieu ce spectacle-happening, Prologue au Regard du Sourd. En somme, la boucle est bouclée.
Pierre Breant
07/01/2017
A L’Espace Pierre Cardin (1 Avenue Gabriel, Paris 8e- métro : Concorde) du 15 décembre au 21 janvier à 20h30. Les dimanches à 15h. Réservations : sur le site web, www.theatredelaville-paris.com. Par téléphone : 0142742277

PARIS
La Scène Parisienne

de Ana-Maria Bamberger
Mise en scène de Jean-Philippe Azéma
Serge cherche une pièce à monter avec Mathilde, dont il est éperdument amoureux. Lorsqu’Anton, auteur reconnu mais méfiant, accepte de leur confier sa dernière œuvre, il pose une condition non négociable : ne rien changer au texte. Une consigne qui résiste mal à l’énergie des...
L'avis de Clément Freuzo
La Scène Parisienne

PARIS



 Notre cher auteur
Notre cher auteur
de Ana-Maria BambergerMise en scène de Jean-Philippe Azéma
Serge cherche une pièce à monter avec Mathilde, dont il est éperdument amoureux. Lorsqu’Anton, auteur reconnu mais méfiant, accepte de leur confier sa dernière œuvre, il pose une condition non négociable : ne rien changer au texte. Une consigne qui résiste mal à l’énergie des...
L'avis de Clément Freuzo